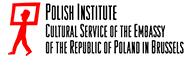Sylwester Bardziński

Né en 1917 non loin de Bydgoszcz. Lorsque la guerre éclata alors qu’il était entré dans l’armée comme volontaire en 1938. Interné en Roumanie, il s’enfuit et parvint en France où il rejoignit l’armée polonaise qui était en train de se reformer. En tant que soldat, il se rendit au Royaume-Uni. Il participa au débarquement de Normandie comme tankiste dans la Première Division blindée du général Maczek.
Malgré ses 95 ans, Sylwester Bardziński est un vétéran plein d’énergie qui parle de ses souvenirs militaires avec facilité et chaleur. Sa mémoire excellente, la précision de ses informations et son sens de l’humour font de Bardziński un interlocuteur excellent et un homme qui attire immédiatement la sympathie.
En 1939, j’étais déjà dans l’armée. Après avoir terminé l’École Nationale des Arts et Métiers, l’ingénieur en chef de la commission d’examen nous dit : « Les garçons, vous pouvez tous travailler chez moi. » Chez lui, c’est-à-dire dans sa fabrique de pièces d’avion. Puis, il ajouta : « Seulement, vous devez d’abord faire votre service militaire de base. » À l’époque, chacun avait l’obligation de faire deux ans de service. Moi, j’y suis allé en tant que volontaire en octobre 1938 et, un an après, le 1er septembre, la guerre éclatait. Je terminais alors ma première année à l’école des sous-officiers. Quand la guerre éclata, je me rendis compte que je pouvais tirer un trait sur mon rêve de finir l’armée et de prendre pour de bon le poste promis par l’ingénieur.
Le début de la guerre
Une mobilisation secrète avait commencé avant que la guerre n’éclatât, car l’Angleterre ne permettait pas à la Pologne de se mobiliser officiellement afin de ne pas provoquer l’Allemagne. En Pologne, il existait alors une loi qui imposait à quiconque ayant une voiture de la céder à l’armée. À Bydgoszcz, je servais dans le 8e Bataillon Blindé. Les propriétaires amenaient leurs voitures sur la place du marché, recevaient une fiche signée et partaient. Les véhicules furent distribués aux régiments de Bydgoszcz et ceux qui restaient devaient être chargés dans des wagons et transportés jusqu’à Varsovie. Le chef de ce transport était un sergent de notre unité. Il avait besoin de dix volontaires pour l’escorter. J’étais un de ces volontaires. Le train traîna pendant environ deux jours. Le 1er septembre au matin, alors que nous étions en train de décharger les wagons sur l’embranchement, nous entendîmes les premières bombes et les premiers coups de feu. L’Allemagne avait attaqué la Pologne. Tout le monde sortait, regardait et ne parvenait pas à croire que c’étaient des avions allemands. Pendant la guerre, je ne vis pas un seul avion polonais. En revanche, il y en avait beaucoup d’allemands. En journée, il n’était pas possible de se déplacer en colonne, car les avions de chasse pointaient immédiatement. Quand nous eûmes déposé toutes les voitures, nous reçûmes l’ordre de ne pas retourner à Bydgoszcz, mais d’aller à Łuck1 , où se trouvait 12e Bataillon Blindé. Les chasseurs surgirent pendant le trajet du train. Le train s’arrêta. Tous en sortirent en courant, prenant la direction des champs. Les Allemands commencèrent à faire des victimes. Ils allaient et venaient, ils tiraient tellement bas que j’entendais leurs ricanements. La pire chose à faire quand un avion approchait était de fuir ! Le mieux était de se coucher directement par terre et de ne pas bouger. Un de nos collègues fut abattu sur place. Je sautai du wagon dans le fossé et je ne pensai même pas à bouger. Alors que j’étais assis là, je remarquai une jeune fille de dix-sept ou dix-huit ans. Elle courait comme une folle, elle était sous le choc et répétait sans cesse : « Que dois-je faire maintenant ? Que dois-je faire ? » À côté, dans le fossé, il y avait une femme sereine. Elle dit à la jeune fille : « Assieds-toi et prie ! » Celle-ci s’assit docilement et se calma. Cette situation fortuite dont je fus le témoin resta gravée dans ma mémoire.
Nous nous rendîmes à Łuck en colonne. Quand nous réussîmes enfin à l’atteindre, tout le détachement montait péniblement dans les véhicules et quittait la caserne. Nous nous postâmes dans la forêt. Le 18 septembre, les Russes entraient déjà en Pologne. De notre position, nous voyions un char russe entouré de fumée. Le commandant de notre transport était alors un jeune sous-lieutenant. « Allons vers eux, vers ces Russes », dit-il, ordonnant à deux volontaires de prendre les devants. Autant toute notre compagnie était en rang, autant tous reculèrent vers l’arrière en entendant ces mots et s’enfuirent au fin fond de la forêt. Moi, je ne bougeai pas de ma place… Nous descendîmes auprès de ces Russes. Ils étaient tout barbouillés d’huile, ils étaient si noirs que l’on ne voyait même pas la couleur de leur uniforme. Ils nous affirmèrent : « Nous venons battre les Germains avec vous ! » Sur ce, nous sortîmes des cigarettes et leur en offrîmes. Le soir, le sous-lieutenant nous dit que nous allions à la frontière roumaine où du matériel militaire nous attendait. Nous nous dispersâmes chez des habitants pour la nuit. Notre commandant nous assura qu’il nous réveillerait si quelque chose devait se passer pendant la nuit. Cinq d’entre nous dormaient dans le foin d’une grange chez un riche fermier ukrainien. Le matin, vers cinq heures, il vint nous trouver et nous dit à moitié en ukrainien : « Mais qu’est-ce que vous foutez encore là ? » Nous étions très surpris. Il nous dit que notre armée était déjà partie et que des colonnes russes avaient roulé dans les environs pendant toute la nuit. Du coup, nous lui demandâmes à quelle distance se trouvait la frontière roumaine. Il nous répondit qu’elle était à environ cinq kilomètres. Avec nos carabines, nous gagnâmes la frontière roumaine par des fossés. Notre colonne y était déjà. Nous retrouvâmes nos sacs à dos et nos capotes dans l’un des véhicules. C’était le 19 septembre. Nous restâmes à la frontière toute la journée. Finalement, un officier supérieur roumain arriva et nous dit : « C’est soit l’un, soit l’autre. Soit vous allez en Roumanie, soit vous quittez la frontière ! » Plusieurs firent demi-tour, mais moi je me disais : « Quoi, retourner à Bydgoszcz depuis la frontière roumaine ? Tomber entre les mains des Russes ou des Allemands ? » Nous allâmes en Roumanie avec toute la colonne. J’étais assis dans un camion qui transportait toutes les réserves nécessaires aux véhicules militaires qui étaient utilisés en Pologne à l’époque. Dans l’armée, ma spécialité était appelée « patrouille rép’ », la patrouille de réparation : j’étais mécanicien. Dans le camion, il y avait différents pneus, des pièces de rechange, etc. Nous entrâmes en Roumanie. Quand les Roumains virent ce que nous avions dans ces camions, ils voulurent que nous les leur vendions. Mais nous avions peur parce qu’en Pologne la propagande disait qu’une armée qui allait à cette époque au front en train se voyait inscrire à la craie : « Nous nous voyons dans 14 jours à Berlin ». La propagande était ainsi en Pologne, et le soldat y croyait. Nous étions cinq gars du service actif. J’avais 80 grosz pour dix jours. Nous avions besoin d’argent, mais nous avions peur de vendre quoi que ce fût aux Roumains, craignant que l’on commençât à nous demander à notre retour en Pologne où étaient passées certaines pièces. Nous passâmes trois jours dans cette localité. Je ne me souviens pas de son nom. De nombreux Polonais vivaient à la frontière roumaine. Une fois, une dame passa dans la rue et nous dit : « Les garçons, vous aimeriez peut-être vous rafraîchir, vous laver ? » Nous dîmes que oui, mais nous ne savions pas quand nous partions. Elle nous dit qu’elle habitait juste derrière le coin. Ainsi, l’un après l’autre, nous allâmes prendre un bain, nous reçûmes même un café. Un véhicule rempli de soldats roumains avec des carabines arriva après trois jours. Ils nous conduisirent dans un pré, ils rangèrent les véhicules que nous avions et nous emmenèrent dans une caserne militaire, dans un endroit appelé Turnu Severin. C’était une caserne d’artillerie. Ils nous installèrent dans les écuries. Nous n’avions aucun contact avec les officiers. La seule personne qui pouvait nous rendre visite était le prêtre. Mais nous pouvions nous échapper du camp. À ce moment-là, en Roumanie, la propagande encourageait à fuir vers la France, car le générale Sikorski y constituait une armée polonaise moderne. Nous passâmes deux-trois mois dans les écuries, et, pendant ce temps, les Roumaines construisaient pour nous des baraquements à un autre endroit.
Nous nous rendîmes à Łuck en colonne. Quand nous réussîmes enfin à l’atteindre, tout le détachement montait péniblement dans les véhicules et quittait la caserne. Nous nous postâmes dans la forêt. Le 18 septembre, les Russes entraient déjà en Pologne. De notre position, nous voyions un char russe entouré de fumée. Le commandant de notre transport était alors un jeune sous-lieutenant. « Allons vers eux, vers ces Russes », dit-il, ordonnant à deux volontaires de prendre les devants. Autant toute notre compagnie était en rang, autant tous reculèrent vers l’arrière en entendant ces mots et s’enfuirent au fin fond de la forêt. Moi, je ne bougeai pas de ma place… Nous descendîmes auprès de ces Russes. Ils étaient tout barbouillés d’huile, ils étaient si noirs que l’on ne voyait même pas la couleur de leur uniforme. Ils nous affirmèrent : « Nous venons battre les Germains avec vous ! » Sur ce, nous sortîmes des cigarettes et leur en offrîmes. Le soir, le sous-lieutenant nous dit que nous allions à la frontière roumaine où du matériel militaire nous attendait. Nous nous dispersâmes chez des habitants pour la nuit. Notre commandant nous assura qu’il nous réveillerait si quelque chose devait se passer pendant la nuit. Cinq d’entre nous dormaient dans le foin d’une grange chez un riche fermier ukrainien. Le matin, vers cinq heures, il vint nous trouver et nous dit à moitié en ukrainien : « Mais qu’est-ce que vous foutez encore là ? » Nous étions très surpris. Il nous dit que notre armée était déjà partie et que des colonnes russes avaient roulé dans les environs pendant toute la nuit. Du coup, nous lui demandâmes à quelle distance se trouvait la frontière roumaine. Il nous répondit qu’elle était à environ cinq kilomètres. Avec nos carabines, nous gagnâmes la frontière roumaine par des fossés. Notre colonne y était déjà. Nous retrouvâmes nos sacs à dos et nos capotes dans l’un des véhicules. C’était le 19 septembre. Nous restâmes à la frontière toute la journée. Finalement, un officier supérieur roumain arriva et nous dit : « C’est soit l’un, soit l’autre. Soit vous allez en Roumanie, soit vous quittez la frontière ! » Plusieurs firent demi-tour, mais moi je me disais : « Quoi, retourner à Bydgoszcz depuis la frontière roumaine ? Tomber entre les mains des Russes ou des Allemands ? » Nous allâmes en Roumanie avec toute la colonne. J’étais assis dans un camion qui transportait toutes les réserves nécessaires aux véhicules militaires qui étaient utilisés en Pologne à l’époque. Dans l’armée, ma spécialité était appelée « patrouille rép’ », la patrouille de réparation : j’étais mécanicien. Dans le camion, il y avait différents pneus, des pièces de rechange, etc. Nous entrâmes en Roumanie. Quand les Roumains virent ce que nous avions dans ces camions, ils voulurent que nous les leur vendions. Mais nous avions peur parce qu’en Pologne la propagande disait qu’une armée qui allait à cette époque au front en train se voyait inscrire à la craie : « Nous nous voyons dans 14 jours à Berlin ». La propagande était ainsi en Pologne, et le soldat y croyait. Nous étions cinq gars du service actif. J’avais 80 grosz pour dix jours. Nous avions besoin d’argent, mais nous avions peur de vendre quoi que ce fût aux Roumains, craignant que l’on commençât à nous demander à notre retour en Pologne où étaient passées certaines pièces. Nous passâmes trois jours dans cette localité. Je ne me souviens pas de son nom. De nombreux Polonais vivaient à la frontière roumaine. Une fois, une dame passa dans la rue et nous dit : « Les garçons, vous aimeriez peut-être vous rafraîchir, vous laver ? » Nous dîmes que oui, mais nous ne savions pas quand nous partions. Elle nous dit qu’elle habitait juste derrière le coin. Ainsi, l’un après l’autre, nous allâmes prendre un bain, nous reçûmes même un café. Un véhicule rempli de soldats roumains avec des carabines arriva après trois jours. Ils nous conduisirent dans un pré, ils rangèrent les véhicules que nous avions et nous emmenèrent dans une caserne militaire, dans un endroit appelé Turnu Severin. C’était une caserne d’artillerie. Ils nous installèrent dans les écuries. Nous n’avions aucun contact avec les officiers. La seule personne qui pouvait nous rendre visite était le prêtre. Mais nous pouvions nous échapper du camp. À ce moment-là, en Roumanie, la propagande encourageait à fuir vers la France, car le générale Sikorski y constituait une armée polonaise moderne. Nous passâmes deux-trois mois dans les écuries, et, pendant ce temps, les Roumaines construisaient pour nous des baraquements à un autre endroit.
1 Située en Volhynie, la ville de Łuck était polonaise dans l’entre-deux-guerres. Aujourd’hui, elle se trouve en Ukraine et est appelée Loutsk. [NdT]
L'Internement
Si nous donnions quelques lei à un simple soldat, il nous laissait aller en ville. Quand il devint évident que nous allions être déménagés vers un nouveau camp, le prêtre vint et nous conseilla : « Les gars, que celui qui veut fuir maintenant fuie, car ce sera peut-être beaucoup plus difficile de partir du nouveau camp. » Le soir, je pris donc la fuite comme prévu avec Pietrek, un copain de Poznań qui avait le même âge que moi. J’avais environ cinquante lei sur moi. J’y allai en premier, comme nous avions convenu que je devais les corrompre pour pouvoir passer. À la garde, ce n’étaient déjà plus de simples soldats, mais une police militaire professionnelle. Comme ils ne voulaient pas nous laisser sortir, je leur donnai d’abord cinq lei, puis dix, puis tout ce qui me restait. « Tiens, tiens, tiens ! » Ils me prirent par le col. L’un d’un côté, l’autre de l’autre côté, et ils m’emmenèrent au poste de garde. Mon copain et moi parlions tout le temps en polonais. À un moment, il s’écria : « Sylwek, va-t’en ! » Je tournai les talons et sauve-qui-peut. Je me précipitai dans l’écurie n°17 qui était vide. Quand je m’y engouffrai, je vis qu’il y avait deux petites pièces des deux côtés de l’entrée de l’écurie et que l’interrupteur se trouvait au milieu de l’écurie, sur un poteau. Je vis donc que je m’étais trompé, que ce n’étais pas mon écurie, mais je ne courus pas plus loin, je filai juste derrière la porte et entrai dans cette petite pièce. Ils coururent allumer la lumière, et moi je sortis pendant ce temps, les mains dans les poches, en sifflant. Tout le corps de garde tirait alors que je m’enfuyais : tous furent alarmés. Ils m’attrapèrent et me conduisirent à un endroit où se trouvaient quarante-neuf autres fugitifs comme moi. Le deuxième jour, quand eut lieu le déménagement, on nous déménagea séparément. Nous étions menés par des soldats avec baïonnette au fusil. Et pendant que nous marchions, je vis le copain qui s’était enfui avec moi : il se promenait dans la rue avec une jeune fille sous le bras. Elle l’avait certainement sorti des rangs de l’armée. Ce fut la dernière fois que je le vis. Ils nous entassèrent dans un wagon rouge à bestiaux. La porte était ouverte, mais les deux côtés étaient gardés par un soldat avec une carabine. À un moment, un des nôtres s’approcha. Il dit qu’un de ses copains était assis dans ce wagon et demanda s’il pouvait lui rendre visite. Le soldat alla chez l’officier Robiński et accepta ensuite de faire entrer le pauvre diable. Il entra, trouva son copain, le vêtit de la capote militaire qu’il venait d’enlever et lui ordonna de sortir. Dix minutes plus tard, il sortit à son tour. Mais le soldat roumain dit : « Quoi ? Il y en a un qui entre et deux qui sortent ? Ce n’est pas possible ! » Alors, ils se mirent à nous compter dans le wagon : « Camarad unu, camarad doi… » Et nous, nous tournions et nous étions toujours de trop. Le train finit par démarrer et nous amena dans une nouvelle localité qui s’appelait Târgu Jiu. Nous nous demandions ce qu’ils avaient maintenant l’intention de faire de nous. Arrivés sur place, ils ouvrirent les wagons et dirent : « Haide, la camarazi! Fuyez chez vos copains ! » Et ils nous laissèrent sortir. Dans le nouveau camp, il y avait des baraquements en bois : quatre fenêtres, une porte et deux cent quarante hommes entassés dans un baraquement. Il n’était pas possible de s’échapper de là. Il y avait du fil barbelé tout autour, puis quatre mètres d’espace vide et encore du fil barbelé. Ils pouvaient y aller en voiture, la garde était montée et les sentinelles s’appelaient toute la journée. « Le poste n°1 est en ordre. » L’autre décrochait : « Le poste n°2 est en ordre. » Ils disaient toujours : « postul 100 este foarte bine! » Et nous, le soir, quand nous sortions, nous criions : « podaj drabinę ! »2 Ils s’indignaient que nous les singions et, nous, nous nous tordions de rire. Dans ce nouveau camp, je me fis un nouveau copain. Il n’y avait pas d’eau courante. Donc, chaque matin, ils l’apportaient dans des grands fûts en béton qui étaient tirés sur un traîneau par des mules dirigées par un Roumain de devant. Je dis à mon pote : « Écoute, moi je me mets dans un fût, toi dans l’autre ! Nous passerons. » Tous les jours pendant une semaine, nous allâmes au poste de garde quand le Roumain rentrait. Nous savions qu’il donnait des documents, signait quelque chose, discutait un instant et partait. Et une fois, tandis qu’il rentrait avec ces fûts vides, nous nous mîmes à l’affût. Moi, je sautai dans l’un, mon copain dans l’autre et nous passâmes. Seulement, comment sortir de ce fût maintenant ? Je penchai la tête et finit par voir mon copain : « Fuyons ! », lui dis-je. Nous sautâmes tous les deux dans le ravin. La fuite n’était planifiée que jusqu’à Bucarest où nous devions arriver par nos propres moyens. Là, nous pouvions aller au Consulat Polonais où nous recevrions des vêtements et un faux passeport pour poursuivre notre fuite. Nous ne pouvions pas acheter de billet pour Bucarest. Des Roumains bienveillants nous dirent d’attendre dans le fossé de l’autre côté de la gare, de sauter dans le train et de donner quelques centimes quand nous nous ferions contrôler, et ce serait en ordre. Nous avions environ trois cents kilomètres à faire jusqu’à la capitale. Nous roulions déjà depuis une bonne heure quand le contrôleur entra dans notre compartiment. Enfin, plutôt deux contrôleurs. Il demanda les billets, donc je fis semblant de les chercher. Il nous regarda et s’exclama : « Polonezi! Des Polonais ! » À l’arrêt suivant, il nous remit au chef du mouvement qui téléphona à la police militaire, et on nous emmena. Après quatorze jours, nous fûmes ramenés au camp d’où nous nous étions enfuis. C’était le pire. À notre retour, les collègues des baraquements se moquaient : « Oh ! Les Français sont de retour ! » Pour la deuxième fois, ma fuite n’avait pas été possible. Les commandants de ces baraquements étaient des officiers roumains. Je leur expliquai : « Je n’étais pas dans l’armée. Je suis un étudiant et j’ai fui la Pologne avec l’armée. » J’avais la preuve qu’en Pologne je n’avais pas encore été appelé dans l’armée et que j’étais parti comme volontaire. Ils me transférèrent dans le camp civil de Braşov. Là, nous étions libres. Chaque semaine, un officier roumain venait contrôler si nous étions tous là. Chaque semaine, et même chaque jour, quelqu’un s’échappait. Ces fuites étaient mieux organisées. L’officier venait toujours accompagné de deux soldats. L’un gardait une porte avec sa carabine, et l’autre la deuxième. Les fenêtres étaient légèrement entrouvertes. Quand l’officier nous appelait, nous montrions une fiche avec notre nom de famille. Ils savaient qui avait fui durant la semaine. Moi, par exemple, j’avais trois fiches à la lettre B. Quand ils nous appelaient, nous entrions l’un après l’autre, cela représentait tout un groupe. Il y en avait toujours un qui était retourné, sur le côté à la fenêtre du baraquement, et quand il revenait, il recevait une deuxième fiche. C’est ainsi que je m’enfuis. De Braşov, j’arrivai à Bucarest et là, comme c’était déjà prévu, je reçus de nouveaux habits et un passeport. Nous devions nous diriger vers Zagreb qui était alors encore en Yougoslavie. Là, nous passâmes quelques huit jours et puis nous partîmes vers la France où j’arrivai précisément le 9 mai 1940. Un jour plus tard, l’Allemagne attaquait la Belgique et la Hollande. Le dernier jour, à la frontière, je me frayai un chemin et là je rejoignis l’armée.
Le 3e Bataillon Blindé avait été créé à cinq ou sept kilomètres d’Orange. Les 1er et 2e bataillons étaient déjà au front. À Orange, il y avait un terrain d’entraînement militaire. Chaque matin, nous partions de Sainte-Cécile pour marcher quelques sept kilomètres au soleil. Puis, nous revenions pour le déjeuner et repartions ensuite vers Orange pour s’entraîner. Nous utilisions des chars R17 qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Ils roulaient à une vitesse de sept kilomètres par heure. Nous étions assis par deux à l’intérieur. Il n’y avait aucune radio de sorte que nous communiquions par petits drapeaux. Nous en rigolions. Souvent, nous entrions dans ce char, nous enclenchions la quatrième, nous sortions, il avançait péniblement par lui-même et nous le suivions. En France, la guerre progressait encore plus vite qu’en Pologne. Un jour, l’alarme fut donnée et nous reçûmes l’ordre de partir en train dans le sud, en direction de l’Espagne. Nous arrivâmes à Bayonne, dans un port de pêche. Nous fûmes transportés en canots à moteur sur les Sobieski et Batory, des navires polonais de passagers qui nous attendaient en pleine mer. Ces navires devaient nous conduire en Angleterre. Dans les cabines, il y avait de magnifiques lits superposés et beaucoup d’espace. À peine me fus-je couché cette nuit-là que je dormis tout le voyage. Je naviguais sur le Batory. Le voyage dura vingt-quatre heures. Le navire était tellement chargé que des femmes étaient assises avec des enfants dans les canots de sauvetages qui étaient suspendus sur le côté. Au cas où il y aurait eu une quelconque alarme, ils pouvaient directement mettre les voiles. Notre port en Angleterre était Portsmouth. Là, nous échangeâmes le navire contre un train omnibus. Sur les Îles Britanniques, nous fûmes reçus très humainement. À la gare, nous reçûmes directement deux petits pains et une tasse de thé au lait, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous. Personne parmi nous n’avait jamais bu de thé au lait. Ensuite, nous fûmes amenés à Liverpool, à un endroit où il y avait des courses de chevaux. Là, des tentes dressées dans le stade nous attendaient. Du matin au soir, les compagnies allaient l’une après l’autre à la gare. Là, sur une voie latérale, il y avait un train spécial avec des wagons-douches. Nous y entrions à quarante. Chacun devait se déshabiller entièrement. Quand nous étions à l’intérieur de ce wagon, nous pouvions nous asseoir sur des bancs en bois et alors seulement ils lâchaient la vapeur. Je pensais qu’ils voulaient nous achever. Tout le monde suait comme pas possible. Ensuite, ils nous faisaient passer de cette vapeur dans un deuxième wagon pour prendre une douche. Je me sentis renaître. À la sortie, des habits anglais étaient étalés sur des tables, que du neuf. Nous n’arrivions même plus à nous reconnaître. Après trois jours, quand tous se furent lavés, nous reçûmes chacun dix shillings de la part du roi d’Angleterre et on nous laissa aller dans la rue, dans les cafés, etc. Quand je sortais ces dix shillings pour payer quoi que ce fût, les Anglais répondaient : « No pay, no pay! » Ils nous régalaient tous gratuitement. D’Angleterre, ils nous emmenèrent en Écosse. Les 3e et 4e bataillons furent disloqués et divisés entre les 1er et 2e. Ce fut ainsi que je rejoignis le 1er Régiment Blindé. Je stationnai pendant quatre ans sur les Îles Britanniques. Dès le début, nous reçûmes des carabines ordinaires, comme l’infanterie. Nous effectuions un service de mer, défendant les frontières anglaises car, à ce moment-là, les Anglais s’attendaient encore à une invasion allemande. À partir de 1942, ils commencèrent à nous donner des chars afin d’apprendre à les utiliser. Je roulai dans tous les chars anglais qui furent construits pendant cette guerre. Une compagnie comprenait habituellement deux, trois ou quatre chars, et il fallait apprendre. Deux ou trois personnes étaient habituellement envoyées dans le camp anglais pour que quelqu’un les familiarise avec le nouveau matériel. Quand nous revenions, nous devions partager nos connaissances avec toute la compagnie. J’allais souvent à de tels cours, car j’avais vite appris à parler anglais. Les Anglais étaient très gentils avec nous. Ils nous traitaient mieux que leurs propres compatriotes. C’est bien connu : le Polonais combine toujours. Tant d’années ont déjà passé et chaque année on célèbre des événements. En revanche, personne ne se souvient des femmes qui faisaient tant pour soldats en coulisse. Je répète toujours que le plus grand monument qui devrait encore être érigé revient aux femmes. De nombreuses armées de différents pays stationnaient en Angleterre. Le départ en permission était le seul divertissement du soldat. Ils voyageaient dans divers endroits, dans les grandes villes. Moi, je suis allé à Édimbourg. Le soldat allait soit à des soirées dansantes, soit au cinéma ou au café. Nulle part, il ne manquait de femmes, nulle part ! Elles étaient partout, et pas seulement des jeunes, aussi des femmes d’âge moyen. Pour les soldats, c’étaient des occasions de manger moins cher et de coucher moins cher. Nous, les Polonais, tout comme les soldats anglais, nous avions six jours de congé tous les trois mois. Beaucoup d’entre eux restaient dans la caserne, mais moi je partais toujours en congé. C’était le seul divertissement du soldat. Dans les soirées dansantes, on faisait souvent la connaissance de jeunes filles, on échangeait les adresses et on correspondait. L’histoire s’interrompait ou prenait fin devant l’autel.
À propos de la courtoisie des Anglais, je me souviens d’une anecdote. J’étais à Blackpool avec un copain, nous étions assis sur un banc au bord de la mer, quand une famille anglaise s’approcha. Ils nous demandèrent si la place à côté de nous était libre et s’assirent. « Vous êtes des Polonais ? » La dame nous interpella. « C’est pourtant bien écrit », je répondis. Ils nous invitèrent à prendre le thé, juste derrière le coin. Nous allâmes chez eux. Ils nous offrirent aussi des petits gâteaux et nous dirent : « Quand vous aurez un congé ou que vous serez encore ici, venez chez nous. Vous serez toujours les bienvenus ici. »
Quatre ans passèrent ainsi. En 1943, nous organisâmes d’abord cette 1ère Brigade, car ils n’avaient pas suffisamment d’hommes pour former une division. Sikorski partit donc dans le monde entier pour recruter des volontaires. Il le paya de sa vie. De nombreuses recrues furent trouvées parmi les prisonniers pris à l’armée allemande : c’étaient surtout des Silésiens. On leur demandait s’ils voulaient servir dans l’armée polonaise et eux répondaient qu’ils préféraient cela qu’être prisonniers de guerre. C’est ainsi que nous réussîmes à avoir une division au complet. Nous obtînmes également un Sherman, grâce auquel nous pûmes nous exercer. Ensuite, nous fûmes intégrés à la 21e Armée Blindée dont faisaient aussi partie la 4e Division Canadienne et l’infanterie écossaise. Nous partîmes au front en tant que 21e Groupe Blindé. D’Angleterre, nous atterrîmes en Normandie. J’y étais déjà le 30 juillet, mais nous devions attendre sur le côté que toute la division débarquât. Nous entrâmes en action le 8 août. Les combats commencèrent juste derrière la ville de Caen. Les premières troupes avaient débarqué en Normandie le 6 juin et nous, le 8 août, nous n’étions qu’à trente-cinq kilomètres de la mer. Les Allemands opposaient une si terrible résistance. Les Anglais avaient obtenu trop peu de place pour mettre sur pied une grande armée de l’autre côté. Mon opinion est que si la force aérienne britannique n’avait pas eu un tel avantage sur l’Allemagne, cette invasion n’aurait jamais réussi. Les Anglais préparaient cette invasion depuis deux ans. Mais aucune unité ne débarqua là où il était prévu qu’elle débarquât. Le commandant de chaque unité avait une tâche et des points d’observations donnés, mais, quand les soldats étaient dans le bateau, le capitaine du navire s’approchait d’un endroit qui lui convenait et disait : « Bon, vous y êtes. » Et le commandant n’avait rien à dire, car personne n’était arrivé là où il devait arriver. Nous nous dispersâmes. Puis, le 8 août, quand nous entrâmes en action, le 2e Régiment Blindé partit en avant. Quelques vingt-six chars perdirent la moitié de leur matériel.
Le 3e Bataillon Blindé avait été créé à cinq ou sept kilomètres d’Orange. Les 1er et 2e bataillons étaient déjà au front. À Orange, il y avait un terrain d’entraînement militaire. Chaque matin, nous partions de Sainte-Cécile pour marcher quelques sept kilomètres au soleil. Puis, nous revenions pour le déjeuner et repartions ensuite vers Orange pour s’entraîner. Nous utilisions des chars R17 qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Ils roulaient à une vitesse de sept kilomètres par heure. Nous étions assis par deux à l’intérieur. Il n’y avait aucune radio de sorte que nous communiquions par petits drapeaux. Nous en rigolions. Souvent, nous entrions dans ce char, nous enclenchions la quatrième, nous sortions, il avançait péniblement par lui-même et nous le suivions. En France, la guerre progressait encore plus vite qu’en Pologne. Un jour, l’alarme fut donnée et nous reçûmes l’ordre de partir en train dans le sud, en direction de l’Espagne. Nous arrivâmes à Bayonne, dans un port de pêche. Nous fûmes transportés en canots à moteur sur les Sobieski et Batory, des navires polonais de passagers qui nous attendaient en pleine mer. Ces navires devaient nous conduire en Angleterre. Dans les cabines, il y avait de magnifiques lits superposés et beaucoup d’espace. À peine me fus-je couché cette nuit-là que je dormis tout le voyage. Je naviguais sur le Batory. Le voyage dura vingt-quatre heures. Le navire était tellement chargé que des femmes étaient assises avec des enfants dans les canots de sauvetages qui étaient suspendus sur le côté. Au cas où il y aurait eu une quelconque alarme, ils pouvaient directement mettre les voiles. Notre port en Angleterre était Portsmouth. Là, nous échangeâmes le navire contre un train omnibus. Sur les Îles Britanniques, nous fûmes reçus très humainement. À la gare, nous reçûmes directement deux petits pains et une tasse de thé au lait, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous. Personne parmi nous n’avait jamais bu de thé au lait. Ensuite, nous fûmes amenés à Liverpool, à un endroit où il y avait des courses de chevaux. Là, des tentes dressées dans le stade nous attendaient. Du matin au soir, les compagnies allaient l’une après l’autre à la gare. Là, sur une voie latérale, il y avait un train spécial avec des wagons-douches. Nous y entrions à quarante. Chacun devait se déshabiller entièrement. Quand nous étions à l’intérieur de ce wagon, nous pouvions nous asseoir sur des bancs en bois et alors seulement ils lâchaient la vapeur. Je pensais qu’ils voulaient nous achever. Tout le monde suait comme pas possible. Ensuite, ils nous faisaient passer de cette vapeur dans un deuxième wagon pour prendre une douche. Je me sentis renaître. À la sortie, des habits anglais étaient étalés sur des tables, que du neuf. Nous n’arrivions même plus à nous reconnaître. Après trois jours, quand tous se furent lavés, nous reçûmes chacun dix shillings de la part du roi d’Angleterre et on nous laissa aller dans la rue, dans les cafés, etc. Quand je sortais ces dix shillings pour payer quoi que ce fût, les Anglais répondaient : « No pay, no pay! » Ils nous régalaient tous gratuitement. D’Angleterre, ils nous emmenèrent en Écosse. Les 3e et 4e bataillons furent disloqués et divisés entre les 1er et 2e. Ce fut ainsi que je rejoignis le 1er Régiment Blindé. Je stationnai pendant quatre ans sur les Îles Britanniques. Dès le début, nous reçûmes des carabines ordinaires, comme l’infanterie. Nous effectuions un service de mer, défendant les frontières anglaises car, à ce moment-là, les Anglais s’attendaient encore à une invasion allemande. À partir de 1942, ils commencèrent à nous donner des chars afin d’apprendre à les utiliser. Je roulai dans tous les chars anglais qui furent construits pendant cette guerre. Une compagnie comprenait habituellement deux, trois ou quatre chars, et il fallait apprendre. Deux ou trois personnes étaient habituellement envoyées dans le camp anglais pour que quelqu’un les familiarise avec le nouveau matériel. Quand nous revenions, nous devions partager nos connaissances avec toute la compagnie. J’allais souvent à de tels cours, car j’avais vite appris à parler anglais. Les Anglais étaient très gentils avec nous. Ils nous traitaient mieux que leurs propres compatriotes. C’est bien connu : le Polonais combine toujours. Tant d’années ont déjà passé et chaque année on célèbre des événements. En revanche, personne ne se souvient des femmes qui faisaient tant pour soldats en coulisse. Je répète toujours que le plus grand monument qui devrait encore être érigé revient aux femmes. De nombreuses armées de différents pays stationnaient en Angleterre. Le départ en permission était le seul divertissement du soldat. Ils voyageaient dans divers endroits, dans les grandes villes. Moi, je suis allé à Édimbourg. Le soldat allait soit à des soirées dansantes, soit au cinéma ou au café. Nulle part, il ne manquait de femmes, nulle part ! Elles étaient partout, et pas seulement des jeunes, aussi des femmes d’âge moyen. Pour les soldats, c’étaient des occasions de manger moins cher et de coucher moins cher. Nous, les Polonais, tout comme les soldats anglais, nous avions six jours de congé tous les trois mois. Beaucoup d’entre eux restaient dans la caserne, mais moi je partais toujours en congé. C’était le seul divertissement du soldat. Dans les soirées dansantes, on faisait souvent la connaissance de jeunes filles, on échangeait les adresses et on correspondait. L’histoire s’interrompait ou prenait fin devant l’autel.
À propos de la courtoisie des Anglais, je me souviens d’une anecdote. J’étais à Blackpool avec un copain, nous étions assis sur un banc au bord de la mer, quand une famille anglaise s’approcha. Ils nous demandèrent si la place à côté de nous était libre et s’assirent. « Vous êtes des Polonais ? » La dame nous interpella. « C’est pourtant bien écrit », je répondis. Ils nous invitèrent à prendre le thé, juste derrière le coin. Nous allâmes chez eux. Ils nous offrirent aussi des petits gâteaux et nous dirent : « Quand vous aurez un congé ou que vous serez encore ici, venez chez nous. Vous serez toujours les bienvenus ici. »
Quatre ans passèrent ainsi. En 1943, nous organisâmes d’abord cette 1ère Brigade, car ils n’avaient pas suffisamment d’hommes pour former une division. Sikorski partit donc dans le monde entier pour recruter des volontaires. Il le paya de sa vie. De nombreuses recrues furent trouvées parmi les prisonniers pris à l’armée allemande : c’étaient surtout des Silésiens. On leur demandait s’ils voulaient servir dans l’armée polonaise et eux répondaient qu’ils préféraient cela qu’être prisonniers de guerre. C’est ainsi que nous réussîmes à avoir une division au complet. Nous obtînmes également un Sherman, grâce auquel nous pûmes nous exercer. Ensuite, nous fûmes intégrés à la 21e Armée Blindée dont faisaient aussi partie la 4e Division Canadienne et l’infanterie écossaise. Nous partîmes au front en tant que 21e Groupe Blindé. D’Angleterre, nous atterrîmes en Normandie. J’y étais déjà le 30 juillet, mais nous devions attendre sur le côté que toute la division débarquât. Nous entrâmes en action le 8 août. Les combats commencèrent juste derrière la ville de Caen. Les premières troupes avaient débarqué en Normandie le 6 juin et nous, le 8 août, nous n’étions qu’à trente-cinq kilomètres de la mer. Les Allemands opposaient une si terrible résistance. Les Anglais avaient obtenu trop peu de place pour mettre sur pied une grande armée de l’autre côté. Mon opinion est que si la force aérienne britannique n’avait pas eu un tel avantage sur l’Allemagne, cette invasion n’aurait jamais réussi. Les Anglais préparaient cette invasion depuis deux ans. Mais aucune unité ne débarqua là où il était prévu qu’elle débarquât. Le commandant de chaque unité avait une tâche et des points d’observations donnés, mais, quand les soldats étaient dans le bateau, le capitaine du navire s’approchait d’un endroit qui lui convenait et disait : « Bon, vous y êtes. » Et le commandant n’avait rien à dire, car personne n’était arrivé là où il devait arriver. Nous nous dispersâmes. Puis, le 8 août, quand nous entrâmes en action, le 2e Régiment Blindé partit en avant. Quelques vingt-six chars perdirent la moitié de leur matériel.
2 Signifiant littéralement « Donne l’échelle ! », cette phrase polonaise est phonétiquement proche de l’expression roumaine « post ul 100 este foarte bine! ».
Le champ de bataille
Un jour plus tard, c’était nous – le 1er Régiment – qui étions en avant. Nous chargeâmes pendant toute la journée. Les Allemands reculèrent. Nous étions chargés de monter sur la colline 111 qui était dessinée sur notre carte. Nous ne fûmes confrontés à la résistance allemande que quand nous fûmes déjà tout près. Nous avancions à neuf chars groupés en trois pelotons. Les Allemands étaient tellement bien camouflés que ne voyions pas d’où ils tiraient. Je reçus un premier coup sur le côté du char, à quelques vingt-cinq centimètres de ma tête. Je dis toujours que je remercie cet Allemand d’avoir si bien visé. Et donc il avait tiré sur mon Sherman. La balle d’environ dix centimètres de diamètre s’était enfoncée dans le fer du char comme une cuillère dans du beurre à une profondeur de trente-cinq centimètres. Mon périscope était cassé, je ne pouvais plus rien voir. L’opérateur radio avait la main sur la culasse du canon et me criait : « Sylwek, va dans la forêt ! » Moi, je ne savais pas où était la forêt, puisque je ne voyais rien. J’ouvris la trappe et quand je me penchai, à ce moment « fschhh ! », une deuxième fois. Précisément à l’endroit où le canon avait bougé. Nous n’attendîmes pas la troisième balle, nous sortîmes tous les cinq du char. Et à ce moment-là, les huit chars prirent feu comme des bougies. Tous ceux qui réussirent à se sauver commencèrent à s’enfuir. Mon char continuait à descendre la colline.
Le soir tomba, nous sortîmes discrètement de la forêt et nous commençâmes à rechercher notre Sherman. Nous ne savions pas si les Allemands étaient toujours là ou pas. Nous sortîmes les revolvers et nous faufilâmes en silence. Il n’y avait personne. « Où allons-nous maintenant ? » Le commandant répliqua : « En avant ! » Le tireur de canon dit : « Tu es fou ! Personne n’est allé aussi loin que nous ! » Et ils commencèrent à se disputer. Finalement, nous vîmes que quelqu’un tirait des fusées blanches derrière nous. C’étaient les nôtres, donc nous fîmes demi-tour. Le deuxième jour, nous reçûmes un nouveau char. Nous changeâmes aussi le commandant de notre char. À sa place vint le prince Poniatowski, le sous-lieutenant Poniatowski. Mon deuxième conducteur avait, lui aussi, des problèmes. Tout au long de l’incident, il avait tremblé comme s’il avait attrapé la fièvre jaune. « Sylwek, je déserte », m’avait-il dit pendant la nuit. Je lui avais répliqué : « Tu as perdu la tête ? Tu vas te prendre illico une balle dans la tête ! » J’allai chez le capitaine et lui expliquai la situation. Mon conducteur fut finalement engagé dans une compagnie professionnelle. Moi, je reçus en retour le copain avec lequel j’avais servi en Écosse. Lui, il était petit, plus petit que moi d’une tête entière, et tellement hardi que, s’il était convaincu d’avoir raison, il était capable de se disputer, même avec un général. D’ailleurs, en Écosse, il s’était disputé avec le chef qui l’avait déplacé dans la compagnie de réserve. On leur demanda donc qui de là-bas était prêt à aller au front en tant que conducteur. Mon copain – il s’appelait Józef Piskorek – demanda : « Chez qui ? » On lui répondit : « Chez Bardziński. » Ainsi, nous passèrent presque tout le temps de la guerre ensemble. Sur le front, les Américains marchaient d’un côté, les Anglais de l’autre, et les Allemands se trouvaient dans une poche. Un général canadien avait élaboré une stratégie que nous ne découvrîmes qu’après les événements, car à cette époque tout était gardé secret et le soldat ne savait que ce qu’il lui était permis de savoir. Nous fûmes chargés d’atteindre le mont Ormel qui était la colline 262 d’après notre carte. Et ce général dit à notre lieutenant : « Regarde bien la carte quand tu monteras sur cette massue » – car la colline y faisait penser par sa forme sur la carte –, « d’en haut tu verras alors tous les chemins par lesquels ils peuvent s’échapper de cette poche ». En discutant de cette façon, ils devaient empêcher les Allemands qui écoutaient de comprendre ce dont il était question. Les soldats furent chargés de rouler sans lumière, de ne pas utiliser la radio et d’aller en haut du mont 262. Nous devions fendre la ligne allemande sur huit kilomètres. Toute la colonne allemande était sur le côté de la route. La route n’était pas large, donc nos soldats leur demandèrent s’ils pouvaient passer. Ils nous laissèrent passer. Nous étions perplexes, nous pensions qu’ils nous attendaient quelque part, que c’était un piège. Et sur cette colline, mon 1er Régiment était suivi par les Canadiens et le 2e Régiment qui devait se diriger du côté de Chambois mais qui arriva à Champeaux à la place. À un certain moment, le contact avec le 2e Régiment fut rompu, ils ne réapparurent que le deuxième jour. Sur la colline, nous restâmes trois jours et trois nuits. Les Allemands nous assaillaient de toutes parts. Notre approvisionnement ne pouvait plus nous parvenir, ils nous parachutèrent du carburant et de l’eau par avion. Le front était très petit, donc une partie de ces provisions alla aux Allemands. Après trois jours, nous réussîmes à fermer cette poche. La nuit, de nombreux Allemands parvinrent à se dégager, mais nous les firent prisonniers pour la plupart. Le premier jour, nous eûmes plus de cinq mille prisonniers allemands et nous ne savions pas quoi en faire. Ils étaient assis, rabougris et épuisés comme des poules malades. Heureusement, nous réussîmes à établir un contact avec les Américains et nous leur remîmes ces prisonniers. Après trois jours, les Canadiens arrivèrent sur la colline. Ce fut notre plus grande victoire. Montgomery en personne dit que les Allemands étaient assis dans une bouteille et que les Polonais étaient à un pas de celle-ci. Mais on ne trouve jamais rien à ce sujet dans les livres. Je ne dis pas que la guerre s’est terminée deux ou trois jours plus tôt grâce aux Polonais. Comme une fois j’étais à l’anniversaire du débarquement en Normandie, j’achetai un livre dont l’auteur était un sergent anglais. Il décrivait les batailles en Normandie. Je l’achetai, curieux de savoir ce que l’on écrivait sur les Polonais. Pas un mot. Sur la dernière page du livre, tous les commandants étaient écrits : il n’y en avait aucun des nôtres. Était-ce sa faute ? C’était plutôt la nôtre ! Ce sont les Polonais qui doivent dire comment cela s’est vraiment passé.
En Allemagne, quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, j’eus plus de chance que de raison. Je roulais toujours en première ligne. Seulement, j’avais été une fois blessé quand j’avais sauté du char au moment où il avait heurté le canon. J’eus des éclats dans la tête et mon copain eut le bras cassé. Je fus une fois blessé et ne perdis qu’un seul char. Quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, la guerre était déjà finie là-bas. Ce jour-là, les Anglais et les Écossais étaient tout fous, ils jetaient leurs casquettes en l’air. Et nous ? Nous, nous savions déjà que nous avions versé notre sang à vil prix, à prix plus bas que celui de l’eau. Notre commandement déclara : « Nous avons commencé les premier et nous voulons terminer les derniers. » Et plus tard, depuis l’Allemagne, nous fûmes autorisés à rentrer en Pologne, mais un à un, comme des fuyards. Notre gouvernement qui siégeait à Londres avait fui la Pologne, tout comme nous. Nous nous étions battus sous ce gouvernement. La Pologne ne voulait pas discuter avec eux, ni avec Sikorski, ni avec Maczek. Par conséquent, tous ceux parmi nous qui le pouvaient restaient à l’étranger. Nous effectuâmes encore un service de deux ans en Allemagne pour les Anglais dans la British Army of Rain. Quiconque voulait être dispensé de l’armée le pouvait, mais il devait prouver où il allait. Plusieurs d’entre nous retournèrent en Angleterre après deux ans, les autres se rendirent en Hollande qui était plus proche. Moi, je restai à Saint-Gilles-Waes, un village que nous avions libéré sur la route d’Hulst et d’Axel. Nous étions dans l’appartement de braves gens. C’était déjà le mois de novembre, le temps de se reposer quelques jours après les combats. Les chars étaient restés dans les prés. Notre commandement avait accepté que les soldats fussent installés chez des civils. Je vécus dans une famille dans laquelle je rencontrai ma future femme, comme il s’avéra plus tard. Ce fut aussi toute une aventure. Ma femme avait un frère cadet qui restait seul à la maison quand leurs parents partaient. Le secrétaire communal vint lui demander : « Combien de soldats vous pouvez accueillir ici ? » Il répondit : « Il y a ces deux pièces. » Quand le père et la mère furent de retour à la maison, le petit dit : « Vous devez préparer ces deux pièces car treize soldats viennent chez nous. » Comme Paris avait déjà été libérée, notre commandant Poniatowski y alla en permission. Nous restâmes entre quatre et cinq jours chez ces gens, jusqu’à ce que nous reçussions l’ordre de rentrer. Poniatowski n’était toujours pas là. En quittant le village, le père de ma femme, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale, nous marqua chacun d’une croix et dit : « Nul d’entre vous ne mourra jamais plus. » Et c’est ce qui arriva. Poniatowski n’avait pas reçu cette petite croix et il connut une mort tragique. Était-ce un hasard ?
Le soir tomba, nous sortîmes discrètement de la forêt et nous commençâmes à rechercher notre Sherman. Nous ne savions pas si les Allemands étaient toujours là ou pas. Nous sortîmes les revolvers et nous faufilâmes en silence. Il n’y avait personne. « Où allons-nous maintenant ? » Le commandant répliqua : « En avant ! » Le tireur de canon dit : « Tu es fou ! Personne n’est allé aussi loin que nous ! » Et ils commencèrent à se disputer. Finalement, nous vîmes que quelqu’un tirait des fusées blanches derrière nous. C’étaient les nôtres, donc nous fîmes demi-tour. Le deuxième jour, nous reçûmes un nouveau char. Nous changeâmes aussi le commandant de notre char. À sa place vint le prince Poniatowski, le sous-lieutenant Poniatowski. Mon deuxième conducteur avait, lui aussi, des problèmes. Tout au long de l’incident, il avait tremblé comme s’il avait attrapé la fièvre jaune. « Sylwek, je déserte », m’avait-il dit pendant la nuit. Je lui avais répliqué : « Tu as perdu la tête ? Tu vas te prendre illico une balle dans la tête ! » J’allai chez le capitaine et lui expliquai la situation. Mon conducteur fut finalement engagé dans une compagnie professionnelle. Moi, je reçus en retour le copain avec lequel j’avais servi en Écosse. Lui, il était petit, plus petit que moi d’une tête entière, et tellement hardi que, s’il était convaincu d’avoir raison, il était capable de se disputer, même avec un général. D’ailleurs, en Écosse, il s’était disputé avec le chef qui l’avait déplacé dans la compagnie de réserve. On leur demanda donc qui de là-bas était prêt à aller au front en tant que conducteur. Mon copain – il s’appelait Józef Piskorek – demanda : « Chez qui ? » On lui répondit : « Chez Bardziński. » Ainsi, nous passèrent presque tout le temps de la guerre ensemble. Sur le front, les Américains marchaient d’un côté, les Anglais de l’autre, et les Allemands se trouvaient dans une poche. Un général canadien avait élaboré une stratégie que nous ne découvrîmes qu’après les événements, car à cette époque tout était gardé secret et le soldat ne savait que ce qu’il lui était permis de savoir. Nous fûmes chargés d’atteindre le mont Ormel qui était la colline 262 d’après notre carte. Et ce général dit à notre lieutenant : « Regarde bien la carte quand tu monteras sur cette massue » – car la colline y faisait penser par sa forme sur la carte –, « d’en haut tu verras alors tous les chemins par lesquels ils peuvent s’échapper de cette poche ». En discutant de cette façon, ils devaient empêcher les Allemands qui écoutaient de comprendre ce dont il était question. Les soldats furent chargés de rouler sans lumière, de ne pas utiliser la radio et d’aller en haut du mont 262. Nous devions fendre la ligne allemande sur huit kilomètres. Toute la colonne allemande était sur le côté de la route. La route n’était pas large, donc nos soldats leur demandèrent s’ils pouvaient passer. Ils nous laissèrent passer. Nous étions perplexes, nous pensions qu’ils nous attendaient quelque part, que c’était un piège. Et sur cette colline, mon 1er Régiment était suivi par les Canadiens et le 2e Régiment qui devait se diriger du côté de Chambois mais qui arriva à Champeaux à la place. À un certain moment, le contact avec le 2e Régiment fut rompu, ils ne réapparurent que le deuxième jour. Sur la colline, nous restâmes trois jours et trois nuits. Les Allemands nous assaillaient de toutes parts. Notre approvisionnement ne pouvait plus nous parvenir, ils nous parachutèrent du carburant et de l’eau par avion. Le front était très petit, donc une partie de ces provisions alla aux Allemands. Après trois jours, nous réussîmes à fermer cette poche. La nuit, de nombreux Allemands parvinrent à se dégager, mais nous les firent prisonniers pour la plupart. Le premier jour, nous eûmes plus de cinq mille prisonniers allemands et nous ne savions pas quoi en faire. Ils étaient assis, rabougris et épuisés comme des poules malades. Heureusement, nous réussîmes à établir un contact avec les Américains et nous leur remîmes ces prisonniers. Après trois jours, les Canadiens arrivèrent sur la colline. Ce fut notre plus grande victoire. Montgomery en personne dit que les Allemands étaient assis dans une bouteille et que les Polonais étaient à un pas de celle-ci. Mais on ne trouve jamais rien à ce sujet dans les livres. Je ne dis pas que la guerre s’est terminée deux ou trois jours plus tôt grâce aux Polonais. Comme une fois j’étais à l’anniversaire du débarquement en Normandie, j’achetai un livre dont l’auteur était un sergent anglais. Il décrivait les batailles en Normandie. Je l’achetai, curieux de savoir ce que l’on écrivait sur les Polonais. Pas un mot. Sur la dernière page du livre, tous les commandants étaient écrits : il n’y en avait aucun des nôtres. Était-ce sa faute ? C’était plutôt la nôtre ! Ce sont les Polonais qui doivent dire comment cela s’est vraiment passé.
En Allemagne, quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, j’eus plus de chance que de raison. Je roulais toujours en première ligne. Seulement, j’avais été une fois blessé quand j’avais sauté du char au moment où il avait heurté le canon. J’eus des éclats dans la tête et mon copain eut le bras cassé. Je fus une fois blessé et ne perdis qu’un seul char. Quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, la guerre était déjà finie là-bas. Ce jour-là, les Anglais et les Écossais étaient tout fous, ils jetaient leurs casquettes en l’air. Et nous ? Nous, nous savions déjà que nous avions versé notre sang à vil prix, à prix plus bas que celui de l’eau. Notre commandement déclara : « Nous avons commencé les premier et nous voulons terminer les derniers. » Et plus tard, depuis l’Allemagne, nous fûmes autorisés à rentrer en Pologne, mais un à un, comme des fuyards. Notre gouvernement qui siégeait à Londres avait fui la Pologne, tout comme nous. Nous nous étions battus sous ce gouvernement. La Pologne ne voulait pas discuter avec eux, ni avec Sikorski, ni avec Maczek. Par conséquent, tous ceux parmi nous qui le pouvaient restaient à l’étranger. Nous effectuâmes encore un service de deux ans en Allemagne pour les Anglais dans la British Army of Rain. Quiconque voulait être dispensé de l’armée le pouvait, mais il devait prouver où il allait. Plusieurs d’entre nous retournèrent en Angleterre après deux ans, les autres se rendirent en Hollande qui était plus proche. Moi, je restai à Saint-Gilles-Waes, un village que nous avions libéré sur la route d’Hulst et d’Axel. Nous étions dans l’appartement de braves gens. C’était déjà le mois de novembre, le temps de se reposer quelques jours après les combats. Les chars étaient restés dans les prés. Notre commandement avait accepté que les soldats fussent installés chez des civils. Je vécus dans une famille dans laquelle je rencontrai ma future femme, comme il s’avéra plus tard. Ce fut aussi toute une aventure. Ma femme avait un frère cadet qui restait seul à la maison quand leurs parents partaient. Le secrétaire communal vint lui demander : « Combien de soldats vous pouvez accueillir ici ? » Il répondit : « Il y a ces deux pièces. » Quand le père et la mère furent de retour à la maison, le petit dit : « Vous devez préparer ces deux pièces car treize soldats viennent chez nous. » Comme Paris avait déjà été libérée, notre commandant Poniatowski y alla en permission. Nous restâmes entre quatre et cinq jours chez ces gens, jusqu’à ce que nous reçussions l’ordre de rentrer. Poniatowski n’était toujours pas là. En quittant le village, le père de ma femme, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale, nous marqua chacun d’une croix et dit : « Nul d’entre vous ne mourra jamais plus. » Et c’est ce qui arriva. Poniatowski n’avait pas reçu cette petite croix et il connut une mort tragique. Était-ce un hasard ?
La guerre dans le Blindés
Quand nous chargions et que nous étions assis dans le char, c’était joyeux, nous riions bien. Mais, dès qu’il y avait un quelconque danger, chacun regardait attentivement dans sa direction. Tout le monde avait peur car nul ne savait s’il allait encore vivre cinq minutes. Tout le monde n’a pas le caractère pour survivre. Le plus important était d’avoir des bons copains dans l’équipage. Quand je fus blessé, ils voulurent m’emmener à l’hôpital, mais je refusai. Je ne voulais pas être affecté après à un autre équipage. Nous étions en phase : chacun connaissait son travail, pouvait compléter les munitions, nettoyer le canon et trouver un endroit pour dormir. Quand nous avions ces bâches qui servaient à recouvrir le char, nous pouvions nous fabriquer une tente. Néanmoins, quand l’ennemi était trop près ou qu’il tirait de trop, nous devions rester dans le char. Parfois, nous restions assis dedans pendant toute la journée. Et quand on nous disait par radio de ne pas sortir, nous devions y dormir. Ce n’était pas facile. Parfois, il y avait une brèche et nous sortions dormir sous le char pour un peu s’étirer. Souvent, je me disais que j’aurais donné n’importe quoi pour me coucher dans la rue, même avec une pierre sous la tête, pourvu seulement que je pus m’étendre et dormir. Il arrivait que nous ne changions pas de vêtements pendant des semaines. Chez nous, les rôles étaient partagés. Par exemple, le principal tireur au canon avait été scout dans sa jeunesse. C’est lui qui nous préparait à manger. Il faisait toujours en sorte que nous mangions quelque chose de chaud le soir. Il partageait les conserves anglaises en cinq et les faisait un peu frire avec un oignon. Il essayait toujours que cela eût du goût. Les deux conducteurs s’occupaient du char de manière à ce qu’il fût toujours prêt à partir le lendemain. L’opérateur radio prenait soin des réserves de munitions. Quand nous en avions épuisé entre vingt et trente, il fallait nettoyer le canon. C’est lui qui s’occupait de cela. Bien qu’il fût officier, Poniatowski restait avec nous. Quand l’occasion se présentait, nous faisions toujours en sorte que le commandant pût dormir dans un appartement. Mais il restait toujours avec nous. Quand nous nous arrêtâmes à Saint-Gilles-Waes, nous dormîmes le premier jour dans une entrée dont le plafond était recouvert de peaux de lapin qui séchaient. Il y avait une petite chambre pour Poniatowski. Alors que nous étions assis tous ensemble le soir, le commandant de la compagnie arriva et s’exclama : « Vous avez pourtant un endroit pour dormir chez ces gens. » Sur ce, Poniatowski répliqua : « J’y suis allé et j’ai vu que ces gens avaient trop peu de place pour eux-mêmes, alors je dors ici avec les soldats. » Une journée ensoleillée, nous nous reposions après le repas, les bérets sur les yeux, et, lui, il se lavait dans cette eau froide. Le capitaine arriva pour contrôler et l’interrogea : « Que faites-vous ? » Sur ce, il répondit calmement : « Vous ne le voyez pas ? » Il ne voulait jamais profiter du confort qui lui revenait. Chaque matin, il allait à la réunion préparatoire pour s’informer des tâches qu’il devait ensuite nous transmettre. Alors qu’il y allait, nous lui préparions du café pendant ce temps. Quand il revenait, il criait : « Ennemi à gauche, ennemi devant. Le café est prêt ? » C’était un chouette gars. Dommage que nous l’ayons perdu. C’était le 22 décembre, quand nous stationnions dans le village hollandais de Sint-Phillipsland pendant l’offensive de von Rundstedt. Les Anglais et les Américains se préparaient à célébrer Noël et le Nouvel An, mais les Allemands firent encore une incursion à leur encontre pour reprendre Anvers. Il y avait justement du brouillard, de la neige et il faisait froid à ce moment-là. Ils profitèrent du fait que les avions ne pouvaient pas voler. Seulement, cela ne leur réussit pas. Il y avait à Sint-Philippsland une tour de château d’eau que les Allemands devaient contrôler, ayant remarqué que des observateurs anglais y étaient postés. Ils décidèrent de faire sauter cette tour. Toutefois, pour tromper tout le monde, ils préparèrent d’abord une attaque contre nous. Nous étions à six chars, placés à l’avant de la compagnie. Sur la digue, au bord de la mer, la garde était tenue par des volontaires hollandais de l’armée clandestine qui s’enfuirent tous quand ils virent les bateaux s’approcher. Les Allemands étaient habillés en blanc. Poniatowski était justement chez les Anglais. Quand il entendit tirer, il arriva sur-le-champ en voiture blindée. En sortant de la voiture, il dit : « Oh, oh ! Cela faisait longtemps que nous n’avions plus entendu de tirs ! » Je lui ordonnai de rentrer dans le char. Il était onze heures du soir. Et lui, plutôt que d’entrer dans l’appareil et de s’enfermer, il baissa les jambes et s’assit sur la tourelle. J’étais justement à l’entrée. Il me dit que je n’étais pas bien positionné. Alors, je lui demandai comment je devais me positionner. Il commença à me donner des conseils par radio sur la manière dont je devais me déplacer : à gauche, à droite, en arrière. « Ratatatata ! » Il en partit toute une série. C’était comme si quelqu’un avait pris des pierres en main et les avait jetées toutes en un coup. Il fut touché à la tête. Il tomba de la tour. Il faisait noir. Il n’y avait pas de contact radio. D’ailleurs, les compagnies étaient trop loin. Je devais prendre une décision et les deux nouveaux gars que j’avais reçus tremblaient de peur. Dans le char, nous avions un passage par lequel nous pouvions rejoindre la tourelle. Józek y parvint et dit : « Sylwek, reculons car il vit encore, il me serre la main. » Il ne savait pas à quel point Poniatowski était blessé. Nous allâmes au village de Stinberg, à une quinzaine kilomètres de l’accident. Je me dépêchai comme je pouvais avec ce char. Là, les infirmiers le tirèrent et dirent : « Oooh ! Dans deux semaines, il sera de retour auprès de vous. » Mais il mourut déjà dans l’ambulance. Le jour suivant, nous allâmes nettoyer le char. Il y avait son béret, un peu de cervelle et, dans son béret, la balle qui avait transpercé sa tête. Quand sa famille de Paris apprit qu’il était mort, sa maman voulut que ceux qui avaient été avec lui dans le char amenassent son corps. Nous passâmes la nuit dans sa maison familiale. La famille était manifestement riche. Il y avait trois ou quatre serviteurs et chacun avait sa voiture. Toutefois, Poniatowski ne le montrait pas. Il ne parlait jamais de lui. Je savais qu’il avait fini une école d’aspirants chez les Anglais. Il parlait bien polonais, mais lentement et il devait réfléchir. Il traduisait sûrement du français. Il avait probablement appris le polonais dans une école, car il avait une bonne prononciation. Nous fûmes très éprouvés par sa mort. S’il n’y avait pas eu cette offensive de von Rundstedt, nous n’aurions certainement pas repris le combat, car nous savions déjà que nous nous battions pour rien. Nous le savions car les frontières polonaises avaient déjà été définies à Yalta. Nous savions qu’il n’y avait pas de retour pour nous. Nous avions libéré les Français, les Belges, les Hollandais, mais nous n’étions pas capables de nous libérer nous-mêmes. Chacun changea de nationalité. Les Anglais voulaient que le plus possible de Polonais rentrât en Pologne. Ils n’étaient plus nécessaires. Des officiers polonais vinrent donc nous trouver pour demander aux soldats : « Que ceux qui veulent rentrer fassent trois pas en avant. » Personne ne sortit du rang. Pourquoi ? Les Américains n’avaient attendu que deux jours aux portes de Paris avant que les Français n’entrassent dans la capitale, car de Gaulle avait dit : « Mon armée entrera la première dans Paris. » En Belgique, ce fut la même chose quand la brigade belge entra dans Bruxelles sous le commandement du général Piron. Et nous, il ne nous était permis que de rentrer individuellement, comme des fuyards. Et pas directement à la maison, mais d’abord dans un camp. Une question se pose : « Pour quelle raison t’es-tu retrouvé en Angleterre ? » Ceux qui servaient dans l’armée allemande n’eurent pas tant de problèmes. Mais nous, nous avions quitté la Pologne pour la Roumanie en 1939. Si je n’avais pas fui à ce moment-là, j’aurais certainement fini entre les mains des Russes. Ils nous dirent que celui qui ne rentrerait pas au pays dans un délai donné serait privé de sa nationalité. D’un côté, c’était même plus confortable pour nous, car il nous était plus facile de demander la nationalité belge si nous avions perdu la nationalité polonaise. Autrement, nous aurions dû d’abord demander l’autorisation aux autorités polonaises.
Après la guerre
Quand nous quittâmes Saint-Gilles-Waes, ma – alors encore future – femme me laissa une petite photo en me serrant la main afin que je me souvinsse d’elle. En étant en Allemagne, je reçus une carte de ma sœur cadette. Pendant toute la guerre, je n’avais eu aucun contact avec ma famille, je ne savais donc pas ce qu’il était advenu d’eux. En 1940, les Allemands avaient embarqué ma sœur, qui dut effectuer des travaux forcés chez un fermier en Allemagne. Elle y passa cinq ans. Après la guerre, elle fit par hasard la rencontre d’un des instituteurs qu’elle avait eus en Pologne. Il était sous-lieutenant de réserve. Mobilisé en 1939, il avait fini en captivité à Lübeck. Ma sœur lui dit qu’elle n’avait plus de nouvelle de moi depuis longtemps. Il lui conseilla alors d’envoyer une carte à la 1ère Division Polonaise Blindée. Si j’étais en vie, j’étais certainement là. Quand je reçus cette information, j’allai trouver le capitaine : « Ma sœur est en vie, elle est à Lübeck », lui dis-je. Il m’ordonna de prendre ma jeep et d’aller la retrouver. Quand j’arrivai à Lübeck, je recherchai d’abord l’instituteur. Je passai la nuit chez lui et il m’amena le jour suivant dans des baraquements en bois où vivaient une cinquantaine de jeunes Polonaises. Quand nous descendîmes dans le pré, toutes les filles penchèrent la tête car elles pensaient que des Anglais étaient arrivés avec des vivres. Ma sœur me remarqua immédiatement, mais elle ne me reconnut pas tout de suite. Quand je marchai dans sa direction, elle finit par sourire et sauta par la fenêtre. Je lui demandai : « Tu viens avec moi ? » Elle me répondit : « Pour sûr, je viens ! » Je l’embarquai avec moi. Nous nous efforçâmes de lui trouver une chambre chez des Allemands. Au début, elle était parmi les soldats. Au déjeuner, elle venait avec moi au mess des officiers. Un jour, mon capitaine me dit : « Écoute, il serait mieux d’amener ta sœur à Maczków. Là-bas, il y a des plus jeunes. » Le nom de Maczków, maintenant Haren, avait été donné à un village allemand par Tadeusz Bór-Komorowski en l’honneur du général Maczek. Je l’emmenai là-bas, mais je venais souvent lui rendre visite. Ma sœur voulait absolument rentrer en Pologne. Je me dis que je pourrais demander à cette famille chez laquelle j’avais logé en Belgique si je pouvais l’y laisser quelques mois, le temps de régler toutes les formalités. Les Belges acceptèrent. Ils se rendirent d’abord chez le secrétaire communal qui leur dit : « Eh bien, s’il me l’amène ici, je me débrouillerai avec elle. » Avec des copains en permission, nous la transportâmes d’Allemagne à Bruxelles, vêtues d’un uniforme de soldat. Elle séjourna là pendant neuf mois, puis repartit en Pologne. Pendant ce temps, je fis meilleure connaissance avec ma future femme. Et je me sentais bien à cet endroit. Il y avait un gars qui avait une entreprise de carrosserie de voiture. Il me demanda si j’étais capable de souder. Évidemment que j’étais capable. Et il m’offrit un emploi. Je dus démissionner de l’armée, obtenir une autorisation du ministère pour pouvoir rester en Belgique et travailler chez lui. Quand j’eus tout cela, j’allai chez mon futur employeur et lui demandai s’il y avait une chambre à louer dans les environs. Quand j’allai le dire à la famille de ma future femme, sa maman me dit : « Quoi ? Tu as une chambre chez nous, mais je ferai attention à ma fille. » Je vécus là pendant un an, je dormais avec son frère, et puis nous nous mariâmes.
La Belgique
Je travaillais en tant que mécanicien monteur. Nous nous installâmes à Saint-Nicolas et je m’y sentis bien. J’essayai aussi d’obtenir au plus vite la nationalité pour ne plus avoir de carte d’identité spéciale. Car lorsqu’on changeait de travail, l’employeur devait à chaque fois écrire une requête et demander s’il était autorisé à engager cet étranger. Il fallait attendre dix ans pour la nationalité, mais à Saint-Nicolas ils firent en sorte que nous devinssions Belges après quatre ans. Par ailleurs, je m’engageai directement chez les pompiers volontaires afin de mieux faire connaissance avec les gens. J’appris le flamand dans la rue et au travail. À cette époque, il n’y avait pas autant d’écoles de langue. Je montai assez haut chez les pompiers, les sept dernières années je servis comme major. J’étais aussi commandant adjoint. J’étais très apprécié là-bas et je m’y sentais comme à la maison. Mais tout le monde n’eut pas eu cette chance, car de nombreux Polonais ne réussirent pas à s’habituer à la vie ici, ils ne connaissaient pas la langue, ils vivaient dans la pauvreté. Ma femme était couturière. Elle avait tellement de travail qu’elle employait deux filles. Les premières années, nous vécûmes chez les beaux-parents qui nous donnèrent plus tard un terrain. Nous y fîmes construire à nos propres frais. J’avais de bons contacts avec les Belges. Après l’entraînement, nous allions toujours boire une bière. Chaque année, il y avait des compétitions pour les services incendie de toutes les communes. Un fois, nous avons même réussi à obtenir la coupe trisannuelle. Il fallait gagner trois ans d’affilée. Et nous y sommes parvenus.
Les camarades de l'armée
J’avais des amis au Canada et en Australie. Chacun était parti là où il le pouvait. Celui d’Australie était avec moi au début, il était amoureux d’une fille d’ici. Mais elle avait un petit ami pianiste et il échoua. Il partit en Australie. Durant le voyage de six semaines en bateau, il fit la connaissance d’une jeune fille. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. Ici, en Belgique, nous nous tenions tous ensemble. À Saint-Nicolas, il y avait un cercle polonais. Ensuite, nous organisâmes un cercle Benelux. Nous partîmes tous ensemble en Normandie, sur le mont Ormel. Nous étions tellement nombreux que nous partîmes à deux bus. Maintenant, je suis seul. Chaque mois, le prêtre venait d’Anvers pour célébrer la messe. La messe était donnée dans la chapelle des sœurs indigentes, comme nous l’appelions. Puis, nous allions toujours au restaurant pour manger un bout ensemble. Le prêtre continue toujours à venir, mais il n’y a plus de véritables soldats à l’office, juste des Polonais qui sont venus ici pour travailler. Moi, je n’y vais déjà plus. Je dois marcher avec une canne. Mais je me sens bien, quoique j’aie nonante-cinq ans cette année.
Les combattants
Lorsque nous déménageâmes en Belgique, il y avait deux différentes unions des anciens combattants. L’une se trouvait à Anvers et collaborait avec le Consulat Polonais. En revanche, l’autre ne voulait pas discuter avec eux. Cette différence persiste jusqu’à nos jours. Ceux qui étaient en contact avec l’Ambassade avaient divers privilèges : des rencontres à l’Ambassade, des voyages en Pologne. Mais nous, non. Si j’allais en Pologne, je n’allais pas à l’Ambassade pour le passeport. Je réglais cela via un bureau qui organisait le voyage et je payais. Ceux qui prêtaient obéissance au gouvernement polonais de l’époque avaient de meilleurs privilèges. Mais quand Wałęsa est arrivé, ils ont senti le sol se dérober sous leurs pieds. Ils ont donc abandonné cette union de communistes et ont rallié la nôtre. Les Polonais aiment bien se disputer entre eux.
Pour la première fois en Pologne
Je me suis rendu pour la première fois en Pologne en 1964. J’avais vu mon frère cadet pour la dernière fois lors du serment, avant la guerre. Il y était avec ma sœur, celle qui travaillait en Allemagne. Il avait alors dix ans. Quand je suis arrivé en Pologne, j’ai dû faire une escale à Poznań. Toute la famille est venue à Poznań pour me saluer. J’ai vu qu’ils étaient sur le perron. Mon frère avait déjà une femme et deux enfants. Ainsi, une fois je leur ai rendu visite, une autre fois c’est eux qui sont venus me voir. Je suis allé cinq ou six fois en Pologne. La dernière fois c’était l’année passée, à Lublin. J’ai été invité à l’ouverture de l’école dite Général Maczek. À Żagań, il y a une division qui a repris nos traditions. C’est pourquoi ils voulaient qu’un vrai « Maczkowiec » fût présent à la cérémonie d’ouverture. Quand je suis arrivé, je leur ai demandé : « Dites, mais que devais-je emporter avec moi ? » Ils m’ont répondu que je ne devais rien emporter, que c’était moi la surprise.
Rédaction du texte : Monika Turek, en collaboration avec Joanna Zielińska
Traduction française : Katia Vandenborre